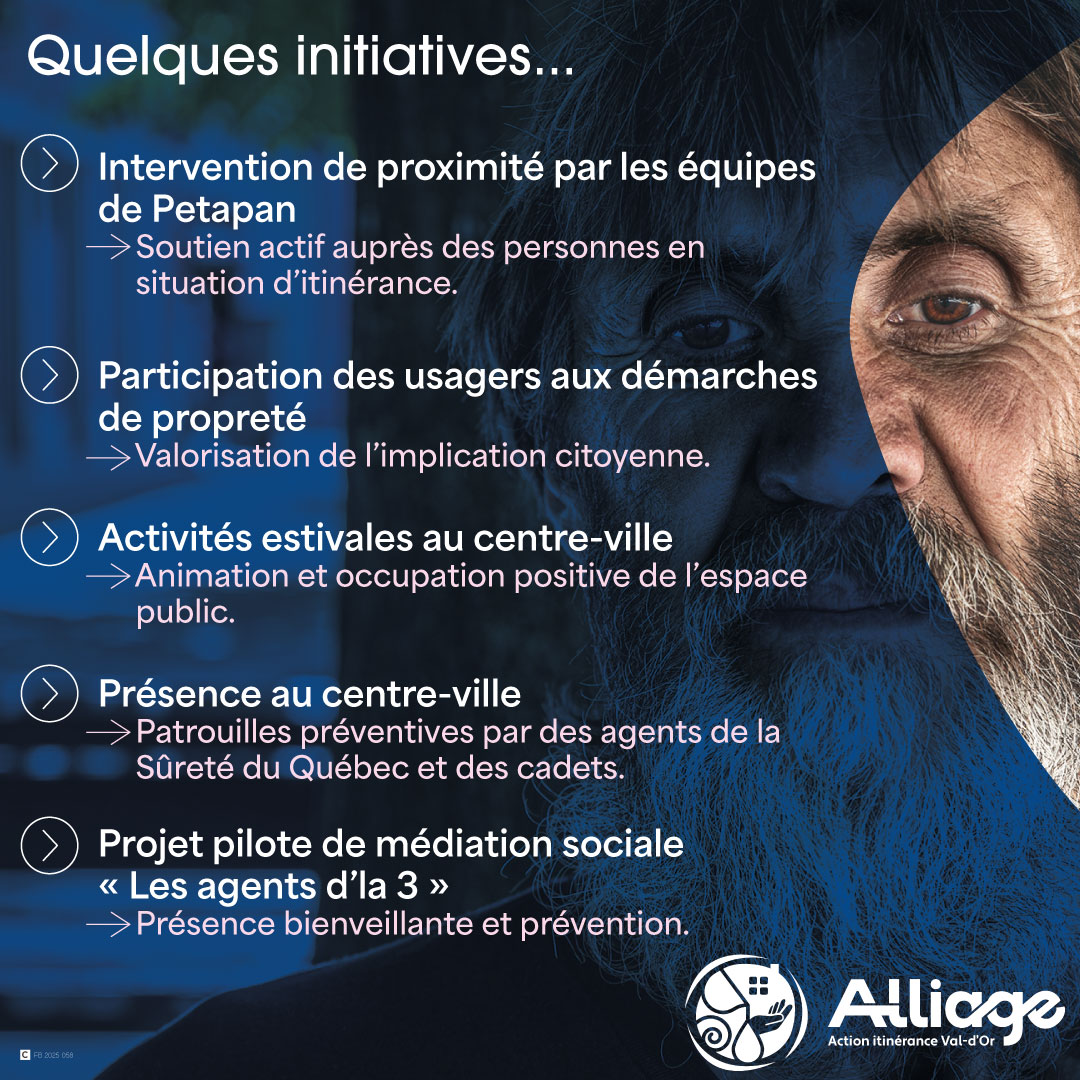Qui appeler?
Si quelqu’un est en danger, si vous êtes témoin d’un crime ou d’un délit, ou si ressentez une menace, contactez la Sûreté du Québec au 310-4141 ou *4141 (avec un cellulaire).
- Pour des questions ou des commentaires
Si vous désirez partager vos observations, des solutions, votre insatisfaction, ou une situation qui se répète et que vous souhaitez voir cesser, contactez la ligne Info-Itinérance au 819 824-9613 poste 2247.
- Pour ce qui touche la salubrité ou la propreté
Si vous observez un problème en lien avec l’entretien des rues ou des parcs, la propreté dans les ruelles, un acte de vandalisme ou les toilettes portatives au centre-ville, contactez la Ville de Val-d’Or au 819 824-9613 poste 2247.
Comment contribuer à améliorer la situation?
Voici quelques ressources et pistes d'action :
- Contribuons à garder notre ville propre.
Disposez de vos déchets dans les poubelles et n’hésitez pas à nettoyer devant votre commerce, dans
les parcs et dans les espaces publics. Bien sûr, il est fâchant de devoir ramasser pour d’autres, mais nous devons, ensemble, briser le cercle vicieux de la négligence et de l’indifférence!
- Soyons des ambassadeurs de notre milieu de vie.
Nos paroles ont un impact sur la perception que nous nous faisons du centre-ville et de la situation de l’itinérance. Il n’est pas question ici de déformer la réalité pour l’embellir, mais il ne faut pas davantage tout noircir et déprécier parce que la situation nous déplaît. Gardons espoir et agissons ensemble : c’est là le meilleur moyen d'améliorer la situation.
- Nourrissons la gentillesse et l’entraide.
Plutôt que la peur et le mépris. Certaines personnes itinérantes sont plutôt malcommodes, mais la plupart sont gentilles et inoffensives. Un sourire et une salutation cordiale ont plus d’impact qu’on le croit.
- Signalez les situations problématiques.
Partagez sans hésiter vos observations, informez la police quand il y a méfait ou crime. Le but n’est pas de criminaliser la misère, mais de documenter la situation et de se donner les moyens d’agir.
Vous pouvez aussi télécharger notre dépliant.